Je suis de cette ville
qui est la ville de ceux qui sont sans ville
Le chemin de cette ville n’a pas de fin
Va, perds tout ce que tu as,
c’est cela qui est le tout.
Jalal al-Din Rumi
L’œuvre de Louise Cara nous convie à un voyage double, au sein du monde des formes et de l’intériorité, et nous rappelle que l’expérience esthétique n’est pas seulement celle de l’œil, mais implique le corps dans son intégrité. Celui-ci sera donc notre guide et se déclinera en trois instances : le corps de l’artiste en quête des lieux aptes à éveiller ce que Kandinsky a appelé « la nécessité intérieure », et engagé dans le corps à corps avec la matière et l’espace, le corps de l’œuvre, fait de matière, d’épidermes, de rythmes et de circulations, d’entrelacs et de recouvrements, enfin le corps du spectateur, puisque nos yeux seuls ne pourraient suffire à expérimenter pleinement les enjeux, les délices et les risques du voyage.
LE TERRITOIRE ATELIER
Si l’atelier d’artiste est par nécessité un lieu sédentaire, il est innervé de parcours nomades. Le carnet de croquis est au peintre ce que le journal de bord est au voyageur : une mémoire où s’entrelacent la topographie des lieux réels, l’histoire personnelle, et les sédiments culturels qui en une trinité indissociable permettent de créer autant d’œuvres palimpsestes. Le fameux « motif » du peintre devient dès lors un miroir à deux faces : le tableau comme « fenêtre ouverte sur le monde », certes, mais aussi un accès à la vie intérieure.
LA CITÉ MIROIR
Le travail pictural de l’artiste prend sa source dans une contemplation spéculaire, méditerranéenne et atlantique. New York, la ville des Skyscrapers, et Fès, la cité de la Médina. De prime abord nous apparaît tout ce qui semble opposer ces deux villes : verticalité et modernité d’une part, horizontalité et tradition d’autre part. Façades intemporelles aux couleurs d’ocre, ajourées de petites fenêtres, ou reflets de verre et d’acier, comme un défi fragile tendu vers le ciel. Pourtant, c’est en puisant aux sources de l’histoire des premiers habitants amérindiens que Louise Cara va fonder une sorte de mythologie contemporaine en regardant les gratte-ciel comme autant de totems. Cette révélation va avoir raison des oppositions entre deux cultures, deux civilisations, et donne à la ville son écriture.
DE LA JUNGLE DES VILLES
Dans son essai Haï, Le Clézio est peut-être lui aussi en quête de leur algèbre secrète quand il écrit sur les villes contemporaines : « En créant les villes, en inventant le béton, le goudron et le verre, les hommes ont inventé une nouvelle jungle dont ils ne sont pas encore les habitants ». La sensibilité poétique ou plastique serait-elle la seule façon d’habiter ces univers artificiels sans s’y perdre ? Pour décrypter ces arcanes, l’artiste observe les formes urbaines sans jamais s’y emprisonner, et privilégie l’essentiel : ici la tension verticale, ailleurs la prolifération horizontale. Le contexte oriente le choix des outils ; dans une pratique itinérante, la fluidité de l’encre permet des notes prises sur le vif, tandis que la pratique au calme de l’atelier diversifie les approches : le dessin sur papier et la gravure, la peinture sur toile, l’encre au pinceau japonais, les enduits…
LA QUÊTE D’UNE ÉCRITURE
Le dessin de Louise Cara ne s’embarrasse pas de l’anecdote des formes. Elle emploie un vocabulaire plastique efficace et concis, sa palette de couleurs est volontairement limitée, et comme dans la peinture de Mondrian, c’est l’orthogonale qui est privilégiée pour traduire le monde urbain. La peinture est avant tout une mise en ordre qui, chez Louise Cara, procède à la façon d’un tissage. Après tout, l’architecture elle-même n’est-elle pas, à l’instar d’une tapisserie, constituée de reports de charges, de lignes de force qui, sur le métier du tisserand, se traduisent par le fil de trame et le fil de chaîne ? Ainsi, la ville n’est pas représentée par l’imitation de ses apparences, mais par une transposition du principe de construction dans l’œuvre picturale.
Le motif urbain fournit à l’artiste son langage formel, mais celui-ci n’en est pas la finalité car, en somme, il pourrait changer demain. Le dessein de son travail est de restituer une sorte de topographie psychique : l’empreinte que les choses ont déposée en soi. C’est ainsi qu’il faut entendre son propos quand elle dit vouloir « rendre visible l’invisible ». La sensation est vécue sur le plan physique, puis à travers une étude des lieux et l’analyse de leurs structures. Le motif est traduit par le langage plastique et renvoie aussi à une dimension symbolique et métaphysique.
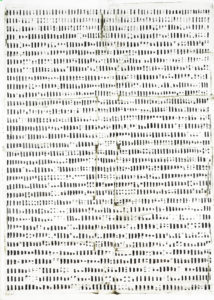
L’ÉCRITURE D’UNE QUÊTE
L’œuvre de Louise Cara procède d’une tension entre frontalité, celle-ci provenant de l’usage des orthogonales déjà évoqué, et d’un jeu subtil sur la profondeur (qu’on trouve dans le cubisme, puis chez Pollock, etc.) qui résulte des glacis, des semis d’encre posés sur les fonds ocrés, tantôt épurés, tantôt riches en matière. La structure de la composition est nourrie par la chaleur sensuelle des matières et de la couleur, et de leur complémentarité naît une œuvre sensible et non conceptuelle. Cette réconciliation des opposés me semble l’essence même de la démarche de Louise Cara, tant sur le plan artistique que spirituel. Pour s’affranchir de tout enfermement dans un système, cette artiste est perpétuellement en quête d’un équilibre visant à résoudre tensions, conflits et forces ; et son inspiration est toujours double, ou plurielle.
DES VILLES DE LA JUNGLE
Louise Cara évoque le vertige face au gigantisme urbain, mais aussi la formidable énergie que génère une ville telle que New-York. Si elle est sensible aux multiples charmes de la ville de Fès, construite à flanc de colline, elle en redoute aussi le caractère labyrinthique, et n’a de cesse que d’en rechercher le fil d’Ariane libérateur. Le labyrinthe, le vertige ne sont pas des expériences anodines. Leur transposition plastique serait-elle alors hommage ou catharsis ? Il y a, jusque dans le nom des séries que donne l’artiste à son travail, le signe d’une synthèse entre tradition et modernité. « Totem City » ou « Urban Kilim » l’adjonction de mots anglo-saxons à des objets traditionnels sacrés est en soi un manifeste qui semble nous dire : certes, j’assume une filiation avec la tradition, mais non, je ne m’y enfermerai jamais.
LE MIROIR DE LA CITÉ
L’élaboration de cette œuvre sur un principe spéculaire est une invitation à la méditation qui va nous aider à dépasser la vision terrestre, au profit d’une vue aérienne, seule capable de nous donner la clef du labyrinthe. Un autre jeu de miroir supplémentaire, ou effet de symétrie, est très intéressant : l’artiste a d’abord travaillé sur chevalet, puis, en fonction des outils employés, tels que les pinceaux chinois et japonais, ou encore les spatules de carrossier, elle en vient à travailler à plat. Par un amusant paradoxe, les icônes de la verticalité que sont les Totems sont donc peints à l’horizontale, tandis que les « Urban Kilim », eux, sont peints verticalement.
Toute forme de tension vise au dépassement des contraires, et s’il s’agit d’une épreuve traversée, éprouvée par le corps, avant de trouver sa forme plastique, celle-ci s’enrichit de la mémoire du monde, à laquelle l’œuvre de Louise Cara rend hommage. Ainsi, l’artiste ne se borne pas à illustrer un sujet préalablement choisi, soit New-York ou Fès, par exemple. Au contraire, elle nous révèle que c’est au cours du travail en atelier que se détermine l’époque ou le continent dans lesquels va s’inscrire tel « Totem City ». C’est pourquoi certains sont nourris de lieux multiples : villes imaginaires, villes invisibles, la peinture est une faconde libertaire
L’ATELIER TERRITOIRE
Revenons une fois encore, mais une fois nouvelle, dans l’antre matriciel, là où tout commence, l’endroit de l’énergie primale, presque primitive, à la fois source de candeur enfantine et creuset de la transmutation alchimique, revenons là où, pour l’artiste, tout a lieu et tout se résout : son atelier. Celui de Louise Cara est vaste et lumineux, spacieux. Elle l’arpente, et peut-être avant d’y peindre, y circule-t-elle ? Tendons l’oreille, car la musique y est reine, et nous parle déjà de sa peinture. Il s’agit de créer les conditions de l’inspiration, au sens fort du terme. Ce sera tantôt la musique soufie, et son lancinant envoûtement, ou bien la rythmique de la musique minimaliste américaine, par exemple.
Ce climat favorable qui permet de mettre le corps en situation, et l’esprit en état de réceptivité, fait-il de l’atelier un refuge ? Louise Cara, en tant que femme, a-t-elle eu, a-t-elle encore, à s’affranchir de forces qui visent à nier la différence, à la réduire au silence ? La série des « Femmes Pinceaux » apporte une guise de réponse. Ces œuvres furent souvent créées lors de performances, physiquement éprouvantes, et on y trouve condensées l’implication du corps et sa représentation. Gardons encore à l’esprit que les grands Totems sont parfois des « Autoportraits ». Peut-être n’avons-nous jamais quitté le fil rouge d’une Ariane vivante en quête de la sortie du labyrinthe ? Ce fil rouge est un corps triple fondu en un acte esthétique : celui de l’artiste qui s’adresse au spectateur par le corps médium qu’est l’œuvre. Là où les différences, les cultures et les civilisations ne se combattent plus mais s’épousent, voilà qu’une œuvre de réconciliation est à naître…
Contexte : Exposition Louise Cara, Totems city — Chapelle des Ursulines, Quimperlé,
Commanditaire : Ville de Quimperlé
Iconographie : Louise Cara